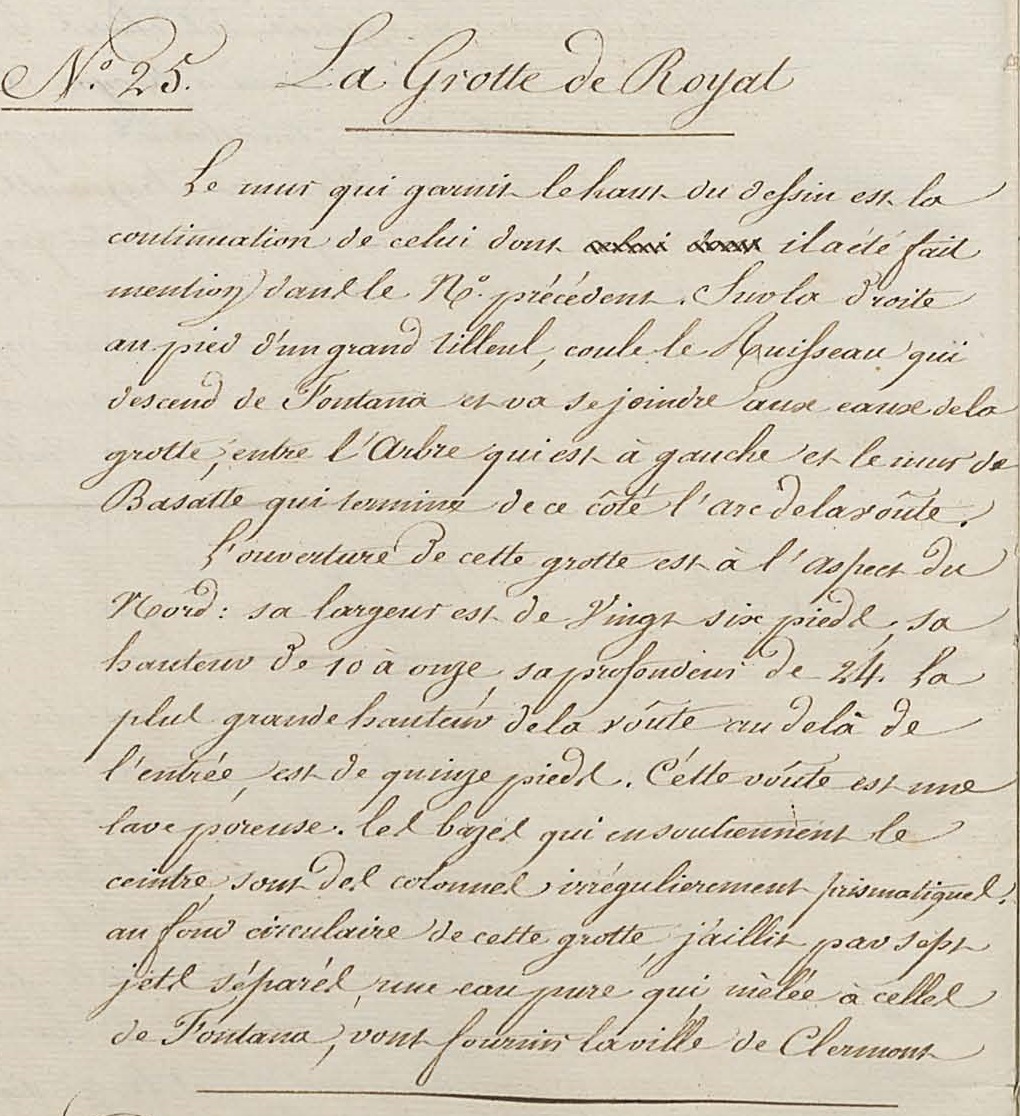61. Les sources de Royat
Numéro carnet
Titre carnet
Crédits photo
Transcription
Le mur qui garnit le haut du dessin est la continuation de celui dont [double rature] il a été fait mention dans le N° précédent. Sur la droite au pied d’un grand tilleul, coule le Ruisseau qui descend de Fontana et va se joindre aux eaux de la grotte, entre l’Arbre qui est à gauche et le mur de Basalte qui termine de ce côté l’arc de la voûte.
L’ouverture de cette grotte est à l’aspect du Nord : sa largeur est de vingt six pieds, sa hauteur de 10 à onze, sa profondeur de 24. La plus grande hauteur de la voûte au-delà de l’entrée, est de quinze pieds. Cette voûte est une lave poreuse : les bazes qui en soutiennent le centre sont des colonnes irrégulièrement prismatiques / au fond circulaire de cette grotte, jaillit par sept jets séparés, une eau pure qui mêlée à celles de Fontana, vont fournir la ville de Clermont.
Commune(s)
Type d'analyse
Auteur
L'ordre des planches dans l'album ne suit pas ici fidèlement l'ordre du carnet. En effet à la fin de son commentaire N° 24 intitulé « L’Eglise de Royat »(correspondant à la planche 55), Delécluze précise :
« Il faut donc se souvenir que ce que l’on voit ici est placé immédiatement au-dessus de ce que le dessin suivant va faire connaître ».
En suivant l'ordre du carnet le commentaire N° 25 est donc consacré à la présente « Grotte de Royat » tandis que dans l'album se trouvent intercalées une deuxième représentation de l'église de Royat (planche 57) ainsi qu'un plan général de la vallée (planche 59) d'un style du reste assez différent. Par sa remarque initiale, Delécluze voulait signifier que la grotte se situe au-dessous de l'église. Le mur de pierre visible dans le haut de l'image et présent sur la planche 55 permet de comprendre la transition entre les deux vues.
Type d'analyse
Auteur
Cette grotte, bien reconnaissable, est située non loin d’un moulin de la Tiretaine, qui coule au premier plan (rivière que Delécluze ne désigne jamais par son nom dans ses commentaires). La végétation joue là aussi un rôle important, mais l’artiste aime aussi représenter les rochers : les orgues basaltiques qui surplombent les jets des sources aux formes géométriques, les rochers bordant le cours de la rivière traversée par un pont de bois, et même une ancienne meule. Au premier plan la porte « à guillotine » du bief du moulin articule l’espace, parallèle aux troncs d’arbres, et aussi au personnage portant un chapeau auvergnat debout sur une planche.
Pour des informations complémentaires sur les moulins de la Tiretaine, voir la planche 59.
Type d'analyse
Auteur
C’est la Tiretaine qui est le ruisseau qui descend cette vallée. Au premier plan elle est dérivée pour alimenter une usine ou un moulin en aval. Une meule abandonnée un peu en amont trahit ce dernier usage.
La grotte est située à la base de la coulée, à l’interface lave-alluvions. Cette cavité, à l’origine remplie de scories lors de la progression de la lave il y a environ 41 000 ans, a été vidée lorsqu’elle a été ouverte par l’action de l’érosion de la Tiretaine. Ainsi a été naturellement mis à jour l’écoulement sous-coulée de l’eau. Dans d’autres vallées, celui-ci a été souvent capté par des galeries.
Type d'analyse
Auteur
Le lecteur d'aujourd'hui s'étonnera que Delécluze n'évoque pas, à propos des sources de Royat, leurs valeurs thérapeutiques. Si le thermalisme connaît un peu partout en Europe un lent renouveau aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans le Puy-de-Dôme ce sont les villages de la montagne volcanique, (Le Mont-Dore, La Bourboule, Saint-Nectaire) dont l'usage n'avait pas complètement disparu depuis la période gallo-romaine, qui font figure de pionniers tandis que les sites limagnais ne sont redécouverts que plus tardivement (Bucaille et al, 2013, p.63).
Ce n'est qu'en 1822, un an après le premier Voyage de Delécluze, qu'un meunier, Claude Gerest, découvre dans les caves de son moulin un puits de construction romaine et une source thermale, qu'il nomme source César et qu'il commence modestement à exploiter (Cheynel, 2006, p.89). En 1843, le curé Antoine Védrine, le maire François-Thibaut Landriot et le fontainier Antoine Zani mettent à jour plusieurs sources chaudes dont la « Grande Source », ultérieurement rebaptisée « Source Eugénie » (Cheynel, 2006). Un véritable établissement thermal verra le jour dans les années 1850 sous l'égide de l'architecte Agis Ledru. Il faudra cependant attendre 1862 et le passage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie pour que la station prenne de l'envergure, grâce notamment à la décision du maire de Royat de créer un parc thermal. Au début des années 1860 Royat commence à se transformer. Toutefois la perception de la localité varie selon les observateurs. D'après Louis Nadeau c'est « un village pittoresque mais sale, au sol humide, boueux, aux maisons humides et décrépites » (Nadeau, 1863, p. 193) tandis que Louis Piesse, qui mentionne dans son guide des eaux thermales dix hôtels destinés à loger les curistes, se fait plus lyrique vantant « Royat, posé dans un vrai nid de verdure ; Royat, dont on aime à se figurer la population vivant contente et heureuse à l’abri de tous les besoins »( Piesse, 1863). Il est vrai que l'auteur insiste plus particulièrement sur la modernité des installations de la petite station :
« L’établissement thermal de Saint-Mart ou Royat […] renferme 70 baignoires, 22 appareils de douches, quatre piscines, deux salles d’aspiration, des salles d’attente, un salon de lecture et le gymnase Pichery. [Dans une annexe du bâtiment principal se trouvent réunis] la machine à vapeur et l’établissement hydrothérapique, alimenté par de très-belles sources d’eau froide. Outre l’hydrothérapie froide, les douches écossaises, tivoli et minérales, froides et graduées, peuvent être administrés à l’aide d’appareils appropriés (…) ; un bain russe y a été aussi placé. […] La cure thermale peut être combinée à Royat avec la cure de petit-lait ou de raisin, ainsi que cela se pratique à peu près dans tous les grands établissements de l’Allemagne. » ( Piesse, 1863, p. 99, 107-108)
C'est à proximité du parc thermal que se situe la grotte représentée par Delécluze, dénommée « la grotte des Laveuses » Plusieurs sources en jaillissant, un lavoir sommaire y avait été aménagé comme en attestent les nombreuses cartes postales du début du XXe siècle.